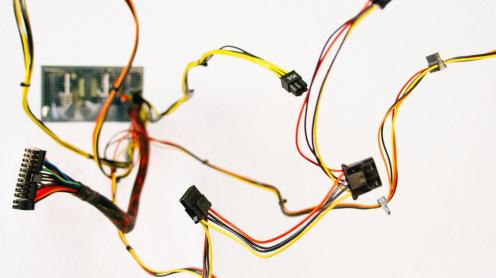Une épouse modèle ? Quand la réputation conjugale dicte les choix économiques

Marché de produit frais, dans un village aux abords du Parc national de Kasungu, au Malawi. Photo : Lex Hes & Boundless Southern Africa via Flickr
L’acheter, ou pas ? Lorsque nous envisageons d’acquérir un bien, de multiples critères pèsent sur notre décision finale. Le regard que porte notre conjoint en fait-il partie ? La question peut être cruciale, en particulier au sein de foyers à très faibles revenus. Pour y répondre, trois économistes viennent de mener une vaste expérimentation au Malawi.
Nos achats sont-ils vraiment guidés par un choix rationnel et cohérent permettant de maximiser notre bien-être tout en minimisant nos coûts ? Ce présupposé de l’économie néoclassique, construit sur le modèle théorique d’un « homo oeconomicus », agent économique autonome et rationnel, est depuis longtemps remis en cause. Biais cognitifs, influence des émotions, poids des interactions sociales pèsent sur nos décisions.
Pensez par exemple à cette magnifique machine à pain, que vous avez acquise l’an dernier sous le regard méfiant de votre partenaire de vie. Utilisée 1 ou 2 fois au plus, elle encombre votre cuisine. Lorsque vous envisagerez l’achat d’une machine à soda, dont vous avez lu tant de bien sur les réseaux sociaux — vous renoncerez peut-être en anticipant le regard agacé de votre conjoint.
Le problème présenté ici peut sembler anecdotique. Mais transposons la situation au cas d’un couple à revenus très contraints, au sein duquel l’épouse serait chargée d’acheter les biens de consommation courants avec l’argent remis par son mari. C’est la situation que connaissent de nombreux pays moins avancés, notamment en Afrique. Le regard de l’époux peut-il conduire les épouses à hésiter devant des achats risqués, par exemple de nouvelles semences inconnues, dont le commerçant vante le rendement ?
C’est précisément à cette question que se sont intéressées trois économistes, Nina Buchmann, Pascaline Dupas et Roberta Ziparo. Spécialistes de l’économie du développement, elles ont conduit une vaste expérimentation au Malawi, un pays rural d’Afrique de l’Est dont les 18 millions d’habitants comptent parmi les plus pauvres du monde, afin de répondre à cette question.
Une question de réputation ?
Leur idée a émergé à l’occasion de deux précédentes études. En 2007, Pascaline Dupas s’est demandé si le prix d’achat d’une moustiquaire (outil majeur de lutte contre le paludisme) influait sur son utilisation. Pour le vérifier, des foyers kényans ont reçu des bons d’achat permettant de faire varier le coût final de la moustiquaire. L’étude a permis de montrer que la gratuité de l’objet n’était pas un frein à son utilisation, contrairement à de nombreux présupposés. Mais au passage, la chercheuse a observé que, lorsque la moustiquaire valait un prix élevé, les femmes étaient plus enclines à l’acheter si le bon d’achat avait été remis aux deux membres du couple plutôt qu’à elles seules. Voilà qui semblait indiquer une réticence des femmes à réaliser une transaction dont le mari ne pouvait vérifier lui-même l’intérêt 1 .
Une autre étude, réalisée l’année précédente en Zambie par des collègues, s’intéressait à l’impact du prix de bouteilles de chlorine pour purifier l’eau potable. 2 Au sein du petit groupe de femmes qui n’avaient jamais utilisé de chlorine avant l’expérience, un comportement étonnant a été observé. Parmi les femmes mariées, celles qui avaient payé le produit étaient plus nombreuses à l’utiliser que celles qui l’avaient obtenu gratuitement. 3 Mais cette différence de comportement ne se retrouvait pas au sein du groupe des femmes célibataires. Être mariée semblait donc inciter à utiliser le produit pour lequel de l’argent avait été dépensé. Peut-être pour éviter d’avoir mauvaise réputation aux yeux de son conjoint ?
Nina Buchmann, Pascaline Dupas et Roberta Ziparo ont donc décidé d’approfondir la question. Des entretiens au Ghana en 2017 les ont confortées. Interrogées, des épouses ont raconté que rapporter à la maison un nouveau produit pouvait effectivement conduire leur mari à diminuer la somme qu’il leur remet — surtout si le produit se montrait peu utile.
- 1
Dupas P., 2009, "What Matters (and What Does Not) in Households' Decision to Invest in Malaria Prevention?" American Economic Review, 99 (2): 224–30.
- 2
Ashraf N., Berry J. and Shapiro J.M., 2010 “Can Higher Prices Stimulate Product Use? Evidence from a Field Experiment in Zambia” American Economic Review, 100 (5) : 2383-2413
- 3
L’ajout de la chlorine à l’eau de boisson permet de la purifier, mais ajoute un goût qui peut faire renoncer à son usage.
Des erreurs qui peuvent coûter cher.
Nos trois chercheuses ont donc mené une vaste expérimentation au Malawi, pour interroger frontalement les stratégies d’achat à l’aune des relations conjugales. Leur travail a débuté par deux jeux, inspirés d’expériences menées en laboratoire, et ici menés au domicile de couples mariés.
Ces jeux ont été construits en tenant compte de la répartition genrée des tâches qu’on rencontre fréquemment au Malawi. Dans le premier jeu, les maris ont reçu chacun 600 kwachas (la monnaie locale). On leur a donné la possibilité d’en remettre une partie à leur épouse : dans ce cas, la somme remise était doublée par les organisateurs. Certains hommes jouaient immédiatement. D’autres étaient d’abord invités à se souvenir des derniers achats faits par leurs épouses.

Un homme avec une liasse de kwachas, la devise locale du Malawi. Photo : Africa via AdobeStock
Les résultats montrent que les maris se rappelant d’erreurs d’achat de leur conjointe lui ont remis une somme inférieure, confirmant ainsi l’impact d’une mauvaise réputation sur la somme dont disposera l’épouse. Mais les conjointes en ont-elles conscience ? Pour le vérifier, un second jeu a été organisé. Les épouses ont été invitées à évaluer la qualité de 6 objets du quotidien (brosses à dents, rasoir, farine, etc.). On leur a ensuite demandé si elles acceptaient, en contrepartie d’une compensation financière, que les résultats du test soient donnés à leur mari. Elles avaient auparavant la possibilité d’utiliser une partie de la compensation financière pour en modifier les résultats. Les femmes dont les résultats du test étaient les plus faibles ont accepté moins souvent que les autres de partager les résultats avec leurs époux. Et lorsqu’elles l’ont fait, elles ont plus dépensé pour améliorer leur score — et donc dissimuler leur manque d’expertise.
Une expérimentation grandeur nature
Ces étapes préliminaires suggèrent que les stratégies d’achat des épouses sont influencées par la crainte de perdre leur réputation aux yeux de leurs maris. Mais comment le vérifier en conditions réelles ? Le moyen le plus fiable pour vérifier cette hypothèse était d’utiliser les essais « randomisés contrôlés ». La méthode consiste à sélectionner des individus aux caractéristiques semblables et à les répartir aléatoirement en deux groupes. Un seul des deux groupes reçoit l’intervention qu’on souhaite évaluer. Puisque cette intervention est la seule variable qui distingue les deux groupes, toute différence peut lui être attribuée.
Cette méthode, empruntée aux essais cliniques utilisés en médecine depuis les années 1950, a été conçue pour améliorer les programmes de lutte contre la pauvreté dans les pays les moins avancés et a valu à Esther Duflo, Abhikit Banerjee et Michael Kremer le prix Nobel d’économie en 2019. Dans le cas présent, l’essai randomisé a été mené au marché de Zomba, un des plus grands du Malawi. Il a inclus plus de 600 femmes mariées.
Un questionnaire a permis de les classer en fonction du degré de compétences qu’elles avaient en matière d’achats. On leur a ensuite proposé d’acquérir deux types de biens inconnus. Le premier était un sac pour conserver les récoltes (maïs, haricot rouge). Une étiquette indiquait que ce sac, qu’on pouvait fermer hermétiquement, permettait de protéger efficacement les récoltes des insectes. L’achat de ce sac semblait peu risqué pour la réputation de l’épouse : s’il n’était pas aussi efficace que prévu, elle pouvait envisager de l’utiliser comme n’importe quel autre type de sac et son mari n’y verrait que du feu.
Le second objet était un livre pour enfant importé de l’étranger — un objet rare au Malawi. Son étiquette mentionnait son utilité pour le développement des enfants. Cet achat pouvait apparaître plus risqué pour l’épouse : si elle n’utilisait finalement pas le livre, son mari s’en rendrait compte facilement puisque le livre resterait sur une étagère plutôt que d’être lu le soir. L’expérience consistait à comparer l’attitude des femmes compétentes (donc ayant bonne réputation) versus les moins compétentes, tout en faisant varier l’information que recevaient les époux quant à l’utilité et/ou au coût des objets.

Une jeune femme Malawi en train de coudre un sac de riz. Photo : Swathi Sridharan via Flickr
Préserver sa réputation
Le résultat a été éloquent. Alors que les femmes les plus expertes dans les domaines considérés ont acheté les nouveaux objets, quelle que soit l’information donnée à leurs maris, les femmes avec moins d’expertise ont moins investi, sauf lorsqu’elles étaient certaines que leur mari avait connaissance du prix et/ou l’utilité du bien qu’elles rapportaient. L’investissement de ces femmes peu compétentes en la matière a été d’autant plus faible que l’erreur éventuelle d’achat était difficile à dissimuler.
L’expérience suggère ainsi que les femmes peuvent hésiter à expérimenter de nouveaux produits. Si l’achat se montre moins judicieux qu’espéré, elles risquent de voir diminuer l’allocation que leur remet leur mari, ou d’être obligées de dissimuler leur erreur en utilisant un produit sous-performant. Des entretiens menés en 2023 au Kenya ont confirmé ces résultats : un tiers des hommes interrogés disent qu’ils réduiraient l’argent donné à leur conjointe si elle achetait des produits insatisfaisants. Symétriquement, plus de la moitié des femmes (56 %) expliquent prendre en compte la réaction attendue de leur mari quand elles décident quoi acheter. Enfin, un tiers des femmes disent continuer à utiliser (ou faire semblant d’utiliser) un mauvais produit, pour éviter que leur mari découvre son inutilité.
Repenser le genre de l’économie
L’expérimentation confirme ainsi le poids du regard du conjoint sur les stratégies d’achat au sein d’un couple. Ce poids peut avoir un impact important dans des pays où les revenus sont réduits et où les femmes dépendent de l’argent que leur remet leur époux.
Mais au-delà, l’expérimentation invite à nuancer les présupposés sur les dispositions économiques des femmes. Celles-ci sont réputées être des investisseuses plus prudentes que les hommes : elles auraient plus d’aversion au risque et prendraient des positions moins risquées. Elles ont d’ailleurs longtemps été les cibles privilégiées des politiques d’aide au développement.
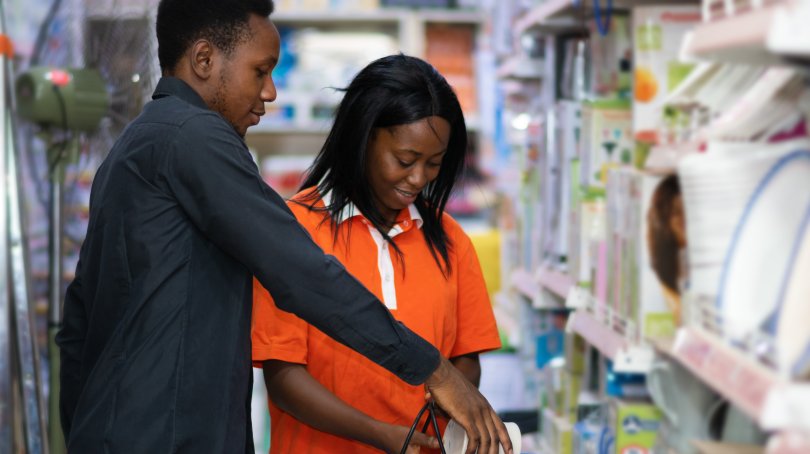
Un jeune couple nigérian en train de faire leurs courses dans un supermarché. Photo : Confidence via AdobeStock
L’expérience menée au Malawi suggère que leur attitude face au risque varie en réalité en fonction du contexte dans lequel elles se trouvent — ici, les femmes craignant moins pour leur réputation étaient prêtes à prendre des risques supérieurs aux autres. Ce résultat fait écho à d’autres travaux récents, comme celui de Renée B. Adams, qui a montré que les membres féminins des conseils d’administration du secteur de la finance étaient moins hostiles au risque que les autres femmes
4
… Voilà qui invite à déconstruire les stéréotypes de genre : les biais dans les comportements économiques relèvent avant tout de la position socio-économique et du contexte dans lequel évoluent les individus, et non de leur sexe. Après avoir déboulonné la statue de l’homo œconomicus, n’est-il pas temps, enfin, de reléguer au passé les clichés sur de supposés comportements "féminins" en économie ?
- 4
Adams R. B., 2025 « Les femmes (et les hommes) dans la finance ne sont pas ‘typiques’ » Revue d'économie financière, 157(1) : 31-45.